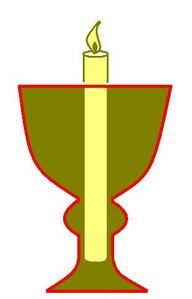extrait de son livre "Dieu, ma mère et moi" (janvier 2012, éd. NRF Gallimard).
« A la maison, il n’y avait pas de livre de Spinoza (1632-1677). Non pas qu’il fût interdit : ce n’était pas le genre de ma mère d’interdire des lectures. Elle le considérait simplement comme un philosophe secondaire. Un panthéiste, ce qui, dans sa bouche, n’était pas à proprement parler une insulte mais voulait dire dépassé, sinon ringard.
Très porté sur le panthéisme, j’ai donc acheté L’Ethique de Spinoza chez un libraire d’Elbeuf et sa lecture fut un des grands chocs de ma vie . A dix-huit ans, je découvrais dans un livre tout ce que j’avais toujours cru sans le savoir. Je lisais mes propres pensées, que j’aurais été bien incapable de formuler. J’étais bouleversé.
Contrairement à Descartes, Spinoza réintègre l’espèce humaine dans la nature. C’est l’anti-Narcisse. Le déconstructeur de l’anthropomorphisme qui conçoit Dieu à l’image de l’homme. Le mauvais esprit ricanant d’une Humanité qui, jusque-là, s’encroyait. Aujourd’hui encore, il y a quelque chose de délicieusement sulfureux dans son œuvre pour qui prend la peine d’entrer dans sa prose monotone.
Mais Spinoza est une sorte de miracle philosophique : avec sa pensée humble et lente en cercles concentriques, il tourne, jusqu’à la toucher par moments, autour de cette vérité du monde qui s’éloigne dès lors qu’on croit l’avoir trouvée. Descartes construit son système en regardant le monde avec ses yeux d’homme. Spinoza fait l’inverse : il regarde l’homme avec les yeux de Dieu dont notre espèce n’est qu’une infime parcelle ?
En quelques jours de lecture compulsive, Spinoza est devenu un ami et son Dieu Univers, le mien. Je ne peux pas affirmer que ce Dieu est celui des chrétiens mais je ne peux pas dire non plus le contraire.
Spinoza a tranché avec une formule qui résume toute son œuvre : Deus sive natura (« Dieu, c’est-à-dire la nature »). Le Très-Haut n’est plus le créateur du monde mais la substance et la cause immanente de tout. Il est nous et le reste. Il n’y a plus d’ordre ni de hiérarchie, mais une dynamique et, pour les êtres humains, une quête de la perfection, chacun étant mû par une nécessité naturelle. L’homme n’est plus un Etat dans l’Etat ; c’est un rien, mélangé à l’univers.
Pour Spinoza, le monde est une sorte de grande soupe où tout se fond. S’il a prouvé Dieu, dans la foulée d’Anselme, Spinoza l’a liquidé en même temps : étant partout, Dieu n’est nulle part ; on ne peut pas l’identifier. Il est à la fois cosmopolite, œcuménique et protéiforme. Il est moi, il est toi, il est l’air que nous respirons et le gazon sur lequel nous marchons.
Descartes n’a jamais essayé de prouver sa propre existence qui, après tout, pouvait être sujette à caution. Pourquoi, alors, s’est-il échiné à prouver celle de Dieu ? Les philosophes se sont ridiculisés chaque fois qu’ils ont essayé de prouver l’existence de Dieu. Une hécatombe qui a fauché les plus grands d’entre eux, de Descartes à Hegel, en passant par Leibniz.
Dieu ne se prouve pas : comme je l’ai déjà dit, il se vit, il se respire, il se boit. Pour le vérifier, il n’y a qu’à regarder plus loin que le bout de son nez, se pencher ou s’agenouiller, on tombera toujours sur lui. Il est donc heureux que la philosophie ait abandonné la métaphysique et la question de Dieu pour des sujets plus triviaux, laissant le Tout-Puissant aux saintes et aux saints, laïcs ou pas, qui en parlent si bien, avec une force et une poésie de l’autre monde. Avec eux, au moins, on n’est jamais déçu. La philosophie a perdu en majesté ce qu’elle a gagné en crédit. Elle est retournée aux sources ; elle ne se mêle plus que de ce qui la regarde : il y avait quelque chose de pathétique à l’observer se tortiller pour percer des mystères qui la dépassaient comme ils dépassent encore aujourd’hui les scientifiques de toutes obédiences.
Quand, en 1882, dans Le Gai savoir, Nietzsche claironne la mort de Dieu, il a évidemment raison. Mais il s’agit du vieux Dieu chrétien des philosophes. Pas du vrai. Nuance. C’est pourquoi ce n’est pas un événement si considérable.
L’autre Dieu, celui qui nous habite, celui de toutes les religions, est, pour sa part, plus vivant que jamais. Il se mélange au vent, secoue les forêts, s’insinue sous les mousses, s’égaie dans les rivières, rit dans les fontaines et remplit nos veines. Il ne cesse de nous donner des preuves de son existence, au point que nous croulons sous celles-ci, de la nuit veloutée qui nous appelle au brin d’herbe en train de s’étirer, tout tremblant, vers le ciel. Ne courez pas, regardez sur quoi vous marchez, vous risqueriez de l’écraser. Ne criez pas et tendez vos oreilles, vous entendrez, derrière les bruits de la civilisation, un bourdonnement d’échos et de murmures, cette rumeur du monde que j’appelle la voix de Dieu et qui nous arrive par une infinité de bouches.
Dieu n’est pas un concept, mais une expérience, du vécu, du brutal qu’on a moins de chances de trouver dans les livres que n’importe où sur la terre, au milieu de grands hêtres gonflés de soleil et débordants de joie ou devant un étang, gorgé de vie grouillante qui, tout en fumant de brume matinale, frémit sous le passage des libellules. C’est une vérité que notre monde a fini par oublier, mais je ne me lasserai jamais de la répéter : pour voir la lumière de Dieu, il suffit d’éteindre les néons, les lampes halogènes et les éclairages urbains. Sans oublier de fermer le poste de télévision. Après ça, le ciel, la mer ou la nature nous sont moins étrangers ».